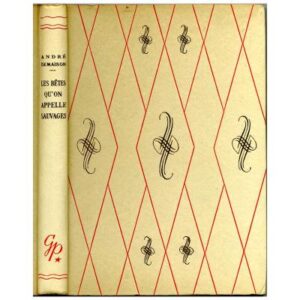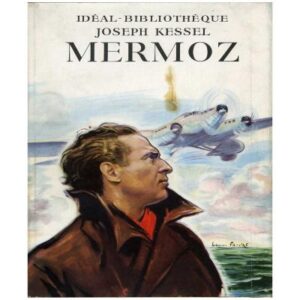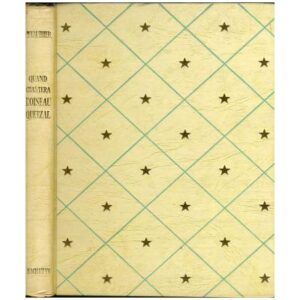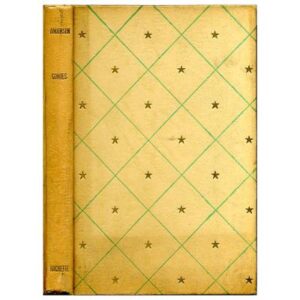29. – LA PHRASE FRANÇAISE.
L’ordre des termes dans la proposition
L’ordre des propositions dans la phrase

L’ORAGE QUI MENACE
Un soir, en Algérie, à la fin d’une journée de chasse, un violent orage me surprit dans la plaine du Chétif, à quelques lieues d’Orléansville.
Pas l’ombre d’un village ni d’un caravansérail en vue. Rien que des palmiers nains, des fourrés de lentisques et de grandes terres labourées jusqu’au bout de l’horizon. En
outre, le Chétif, grossi par l’averse, commençait à ronfler d’une façon alarmante, et je courais risque de passer ma nuit en plein marécage. Heureusement qu’il y avait tout près,
cachée dans un pli de terrain, une tribu.
ALPHONSE DAUDET (Nimes 13 mai 1840- Paris 16 décembre 1897) (Contes du Lundi. Fasquelle, édit.)
Observons et réfléchisons.
1. Quels sont les divers compléments du verbe de la 1ère phrase? Comment est parfaitement assuré l’équilibre de cette phrase? Essayez de la « recomposer »
eb répartissant d’une autre manière les compléments de circonstance.
2. Quelles remarques faison-nous-nous sur la 2è et 3è phrase? Des verbes paraissaient-ils
nécessaires? Ces phrases sont-elles significatives?
3. Dans la 4è phrase, quelle est la valeur expressive du verbe ronfler?
4. Quelle remarque faisons-nous concernant la dernière phrase? La proposition principale est-elle complète? De quel mot dépend la proposition introduite par la
conjonction que?
Notons cette expression familière, en tête de phrase : heureusement que…
Pourquoi ce mot essentiel
– une tribu – est-il placé en fin de phrase?
Recomposez cette phrase d’une autre manière : quelle construction – la vôtre ou celle de l’auteur – vous
paraît la plus évocatrice?
Source = GRAMMAIRE FRANÇAISE CLASSES DE QUATRIÈME FERNAND NATHAN, ÉDITEUR
A. SOUCHÉ Inspecteur de l’Enseignement primaire J. GRUNENWALD Inspecteur Pédagogique Régional
18, RUE MONSIEUR-LE-PRINCE PARIS-VIè
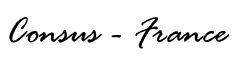

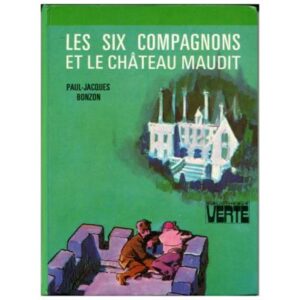
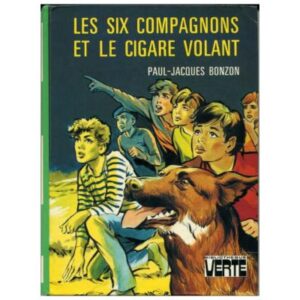
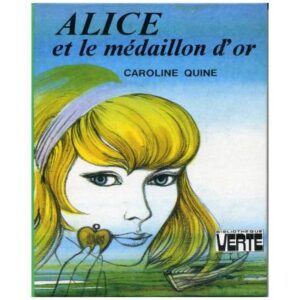
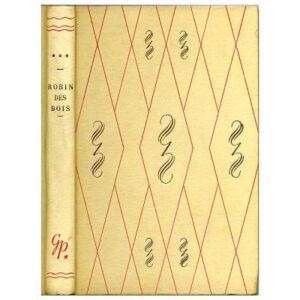
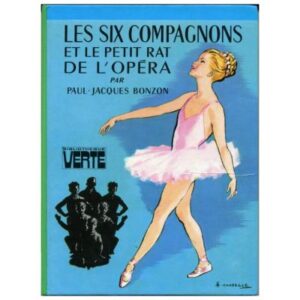
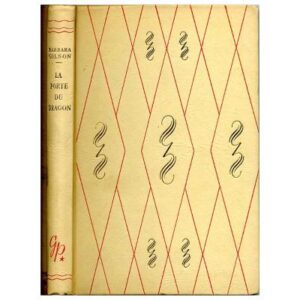
 Nothing Is Little - Carmella Van Vleet
Nothing Is Little - Carmella Van Vleet 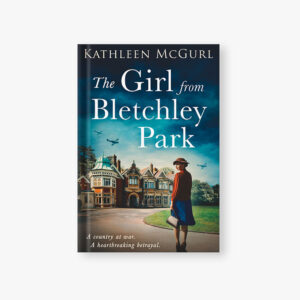 Empires of Bronze: Son of Ishtar
Empires of Bronze: Son of Ishtar